Linhart 68....mai(s) encore!
“Mai, mai, mai, Paris mai...” Claude Nougaro.
Le livre porte sur sa couverture un nom.
En grand.
En noir.
Sur un fond rouge. Le fond de l’air est rouge.
Noir et rouge. Signes de moments révolutionnaires.
Le nom, curieusement, est inscrit sur une pancarte.
Comme s’il avait besoin d’être exposé au vu de tous.
Un nom qui est le patronyme de l’auteure et de quelqu’un d’autre. Cette auteure est en quelque sorte le porte-voix de cet autre. De cet autre qui porte le même nom, qui s’est illustré bien avant elle. et qui est tombé dans l’oubli.
Son père.
Militant et fondateur d’un groupuscule d’ultra gauche au moment de la “période 68”.
Cette illustration est donc, avant tout, une revendication.
Le titre de l’ouvrage, lui, est en blanc et en plus petit.
Secondaire, à première vue. Mais, disons le tout de suite, le titre de l’ouvrage est une précision et non une annonce choc. Comme une histoire ou un récit qui mérité d’être raconté. Mais sans esclandre. Où l’on peut voir que ce qui importe en premier chef, c’est la réaffirmation d’un nom. De ce nom là, justement. De ce que ce nom a porté d’une époque. Porte encore. D’une époque qu’il est possible de réexaminer.
Le nom, ce nom, est désormais rendu public. Enfin présenté, affirmé, au su de tous.
Grâce à elle : Virginie.
Le nom, ce nom, pourtant échappe à la catégorie "people"(pipole).
Virginie Linhart n’écrit-elle pas, à propos de ce père, qu’il est comme une ombre?:
“une ombre sur cette terre où tant de gens se bousculent pour être
remarqués”(p.166).
Faire la lumière d’une ombre, de ce temps de l’image reine, du visuel roi, voilà un projet pour le moins difficile. Et risqué, en regard des critères du temps. Comme ce qui peut apparaître comme une déception, par rapport à une attente, à une révélation.
Déception, en effet, que procure la lecture de ce livre. Quand bien même certains passages du texte vont au plus profond du rapport à soi et parlent de souffrance(s), les révélations qu’il y distille n’y sont pas scandaleuses. Disons, plus justement, nullement obscènes. Car la question de ce livre n’est pas de s’apitoyer sur soi, mais de comprendre ce qui a causé le mutisme d’un père, et de lui redonner enfin un sens. Et du même coup redonner un sens à toute cette époque (les années 68)traversée par la narratrice tant bien que mal eet qui s’est tue après avoir tellement parlé. Toute l’originalité du livre est de tenter ce projet inédit : mener une enquête auprès de celles et ceux, frange de fils et filles de militants en vue lors de Mai 68. Avec l’espoir de trouver auprès d’eux et d’elles des réponses, voire un partage d’expériences voisines....un éclaircissement, en tout cas. Et c’est cette simple différence, ou ce "déclassement" si l’on préfère, de people en public, qui sauve le livre des innombrables mémoires de jeunes filles bien (dé)rangées. Et qui nous fait y prêter attention. Donc, en ces pages, rien de spectaculaire dans ce qui nous est narré. Ici, le spectacle est absent, volontairement absent. A peine quelques scènes-souvenirs, quelques descriptions fugaces. En revanche, des êtres parlent d’autrefois(et même si cet autrefois est un naguère, cela semble à eux-mêmes très éloigné), se racontent, simplement, pris qu’ils sont par leurs occupations et préoccupations d’aujourd’hui. Cependant, quelqu’un, Virginie Linhart, nous fait revivre l’ébullition de cette époque, à travers leurs nombreux témoignages parcellaires, morcelés, réarrangés par montages successifs. Remixés en quelque sorte autour de cette expérience impensable, irréductible, à propos de laquelle chacun(e) tente depuis quarante ans de cerner l’exacte vérité(1), et ce, sans pouvoir la réduire à une unique et suffisante interprétation : Mai 68.
Au travers de cette réminiscence (= remontée) décalée, non celle des acteurs eux-mêmes, mais celle de leurs descendants, l’auteure part à la recherche de son enfance. Ainsi, dans cet ouvrage, le commun et l’individuel se trouvent liés. A preuve qu’elle garde en elle quelquechose de cet événement. Non pas le maoïsme(horizon et fantasme de la révolution de cette période là), simple épiphénomène idéologique, mais ce que note justement René Lévy : “Une expérience du sentiment originel de la fraternité, de la communauté des hommes”(p. 46). Si ce livre dépasse infiniment la personne de l’auteure, et donc, s'il le fait échapper à l’anecdotique (même si celui-ci est important pour elle), c’est en cela. Elle signe ici la trace du manque. D’un manque cruel. Du manque de notre temps. Du manque propre à notre temps. Qui est le temps d’après. Celui du manque qui ne peut être comblé par les biens. Ni par l’excitation générale. Et encore moins par la distraction généralisée.
C’est donc un livre tout autant politique que familial.
C’est
un livre qui ne communique pas des souvenirs (même si de temps à autres
quelques uns émergent), mais laisse place à une “tragédie
paternelle”(p.24) qui est également (à des degrés divers) celle de
toute une génération. Comme Thomas Piketty le souligne dans l’échange
avec Virginie Linhart: “On oublie que 68 a coûté très cher à un certain
nombre de gens qui ont tout plaqué pour des idéaux, puis se sont faits
cueillir par la crise économique des années 70”(p. 103). Et cette
affaire va encore plus loin. L’auteure insiste sur le fait que cet
ouragan a eu un impact par cercles de plus en plus larges : “mai 68 ce
n’est pas seulement l’histoire de nos parents, c’est aussi la mienne;
Complètement. Les événements de mai 68 ont bouleversé ma vie aussi
sûrement qu’ils ont transformé la leur”(p.30).
Le livre prend un aspect emblématique et cathartique. Celui d’un roman (chacun(e) des interviewé(e)s y va de ses errements justement) de non apprentissage, si l’on veut. Dans lequel les parents sont muets, ou en tout cas taiseux, et où se sont les enfants qui parlent et “apprennent” aux parents.
Le roman, donc, d’une enfance compliquée, où le père, Robert Linhart, haut-parleur gauchiste, s’est brutalement arrêté de parler durant plus d’une vingtaine d’années. Le texte du livre est fait d’ histoires des autres, passe par les histoires des autres, entrelacées de bribes de souvenirs de faits personnels. Ces autres qui, comme elle, sont des filles et des fils de militants signifactifs des événements de ces “années 68”. Roman d’une enfance où la place de l’éducation était soumise aux aléas du théorico-pratique des avant-gardes révolutionnaires. Roman d’"éducation" inédite, car jamais pratiquée jusqu’alors en occident.
Quelqu’un se sert donc des autres, des histoires des autres, enfants du grand cercle militant, pour comprendre ce qui est leur arrivé, à ces autres, à elle et bien sûr et surtout, à son père. Et ce, à partir de cet événement, Mai 68, qui l’a façonné, elle, mais également eux, et lui, plus que tout autre, en définitive. Reconduisant au fond, sans le vouloir et en creux, l’affirmation de cette communauté défunte que formait l’étrange (parce que conflictuel) cortège des ultra-gauches. Communauté pas morte, comme on peut s’en apercevoir au fil des pages: le corps vit bien encore. A preuve tous les témoignages rapportés dans le livre. Confirmant ainsi, d'une certaine façon, le slogan énigmatique de 68 :“Sous les pavés, la plage”. Ce moment d’expérience poussée au maximum, quoique recouvert par le flux des jours et des nuits, travaille toujours en sous mains et de façon paradoxale, les corps, les moeurs, les idées, les discours. Chacun(e) trouvera dans l’actualité politique la plus récente un exemple prêt à illustrer cette vigueur.
Le nom du père, donc, en couverture.
Porté à bout de bras.
La main dressée en page de couverture du
livre est là comme pour maintenir l’ensemble du nom et de celui qui le
porte hors de l’eau. Hors du naufrage peut-être. Hors de l’anonymat
sans doute.
Hors du chaos, également.
Ce nom qui, à défaut d’être
celui d’une idole(au hasard : Elvis Presley...), ou d’ une icône(au
hasard : Che Guevarra...), reste celui d’ un symbole ( au hasard
encore: Bruce Lee...). Le symbole, non d’une époque révolue, mais d’une
expérience irrévocablement inscrite dans l’histoire et matrice d’une
exigence qui ne s’éteindra pas de sitôt.
Autres temps, autres moeurs. Certes. Car, alors, en 68, le nom (ce
nom) n’avait pas d’importance. Ni l’origine. Ni l’âge. Ni le statut. Ni
la fortune. Car l’important était ailleurs. Dans le pratico-théorique.
Lisons: dans les discours; la parole offerte à qui voulait la prendre;
les confrontations verbales et physiques. Ce qui, de toutes parts, vous
dépassait. Vous faisait plus grand que soi. Plus haut que soi. Plus
loin que soi. Dans l’effacement du moi. Et, implicitement, dans la
réalisation du rêve des surréalistes et des situationnistes. De l’ici
et du maintenant. Des gens ensemble.
Le temps même était une brèche
dans la linéarité des jours. Jusqu’à en perdre le souffle, le repos, le
souci des siens. Une radicalité inassouvissable. On dira : une folie.
L’importance du nom reprend le dessus. Et avec lui, le reste. Le pouvoir, l’argent, le statut. On connaît aujourd’hui l’extravagance de la recherche généalogique. La question de la lignée. Question de place. Dans ce temps de flux permanent, retouver un espace habitable, ou exploser. Voilà un enjeu d'époque qui travaille en sourdine. Retrouver au plus loin son lignage à travers des enquêtes méticuleuses, grâce entre autres à la puissance d’Internet, est une sauvegarde. C’est se recréer un espace vivable. Car l’après soi est dans l’ingéré, l’imprévisible. Le présent est dans le flou. Seul l’avant, l’antérieur, peut présenter ce repli nécessaire pour souffler, respirer un air moins vicié. On ne saurait en blâmer celles et ceux qui s’y adonnent. Ainsi Virginie Linhart se mêle au consensus et reprend elle aussi le chemin de l’antérieur. Mais l’auteure de cette recherche du temps passé n’est pas tout-à-fait au diapason de cette généalogie-là. Celle de la remontée dans le temps au plus loin. Dans le calme d’un silence apaisé. Car le silence auquel elle a eu à faire face brutalement étaant adolescente est un mutisme, une parole qui s’est tue en vol, pourrait-on dire. C’est le silence du sans voix face à l’épouvante, qu’elle prenne les atours de la médiocrité, de l'arrogance, de l'arrivisme, de la compromission.
Elle cherche juste à comprendre comment, parmi tous ces militants-là qui se sont voués à cette tâche infinissable, son père a rompu cette chaîne et ce qui en a découlé. Pour lui, pour elle. Et, au fond, pour tous les autres qui ont rompu sous la fulgurance du retour à la norme. Comme l’écrit Virginie Linhart, cela s’est fait brutalement : “un jour c’était terminé”(p.138). Et elle ne cherche pas non plus à signaler son recours aux communautés en ligne, par exemple ou aux outils pour retrouver les personnes perdues de vue. Les rencontres sont de face à face, le plus souvent obtenues grâce à cette vielle technique du bouche à oreille. Car cette communauté éclatée, disloquée au fil des ans, reste un réseau même si lâche dans son maillage. C’est encore un petit milieu aujourd’hui. Où tout se sait mais où tout ne se dit pas. Et ces rencontres (le mot est un peu fort car les personnes se rencontrent en fait sur pas grand chose) sont faites de questions et d’écoute. Au gré de ses interlocuteurs et interlocutrices, une histoire se raconte. Le procédé est léger. Sans appareil scientifique très élaboré. C’est presque du bavardage. Et les réponses sont la plupart du temps presque étrangères au propos. De survol. Comme dépourvues de toute densité. Celles et ceux qui étaient au plus près du coeur de 68, seraient-ils donc également celles et ceux les plus éloignés du sujet? La démarche de l’auteure n’est pas technique (à chaque rencontre l’approche n’est pas fixe) mais d'approche "psychologique". Elle soutire des autres le regard qu'elle ne peut tirer d'elle-même. Dans une démarche régressive indirecte nécessitée par l’impossible transmission, pour remonter à sa source (et non à l’origine qui sera introduite dans le chapitre 6: Survivants) de production de ce pathos fondamental intra familial (seule véritable révélation du livre qui s’ancre ainsi doublement dans l’histoire).
Alors oui, un nom. Un nom qui renvoit à une figure (d’intellectuel; de partisan; de leader; de destin contrarié; et de choc irréversible : la fin de l’aventure collective et la fin tragique en 1980 de Louis Althusser, l’homme admiré par le père).
Une figure effacée, donc.
Une figure tragique.
Un nom qui reconduit à un temps que l’on juge aujourd’hui exécrable ou bien simplement
folklorique.
Une figure perdue. Autant dire, avec les simplifications actuelles, une figure qui est devenue par l’effet du temps, un symbole... de perdant.
Et puisqu’il s’est tu, tout juste une trace deci delà au détour du
souvenir, lors d’une interview d’une “célébrité” à propos des
événements de cette période là. Parfois la trace est douloureuse : le
papier de Bernard Henri Lévy dans le journal Le Monde relaté par l’auteure (p. 147 et suivantes).
Retour violent à cette figure.
Figure de proue devenue figure de fou.
Et pourtant, ce nom, ce nom effacé, ce nom relégué, n’est pas indifférent. Le rappel de ce nom également et de ce qui lui est arrivé. Car il porte en lui ce que Walter Benjamin a nommé : “le véritable état d’exception” (p. 433) qui fait frissonner tous les pouvoirs.
Le nom résonne modestement, mais emblématiquement, avec une
expression devenue comme le slogan qui résume tous les slogans : Mai
68.
On aura tout vu et tout entendu à cette occasion. Commémoraton/dénonciation/consolation/consécration.....
On aura fait parler les acteurs (le merveilleux mot!!!) qui ont fait Mai 68.
Autant
de personnages qu’on peut suivre et entendre parcourir sans vergogne,
revenir sans scrupules parfois, sur ces événements qui ont défié le
monde, l’histoire.
Qui ont été en partie leur monde, leur histoire...qu’ils en parlent avec gaieté ou hargne ou indifférence.
Aujourd’hui encore, les bavardages et les "people".
Et ce depuis 40 ans.
On
peut comprendre que ce qui s’est joué dans ces moments-là est difficile
à ranger sous des catégories satisfaisantes. On dira “historial” pour
marquer à la fois l’inscription et la séparation. Autant dire : ce qui
donne le repère à partir de quoi tout peut se juger, se jauger. Hommes
et idées. Politique et culture. Savoirs et sexualités. Etc...
Virginie Linhart revient donc sur cette époque là, mais pour donner la parole à celles et ceux qui, alors enfants, sont venus à maturité après. Car au sein de sa vie, il y a du tragique. Robert Linhart a succombé à cette trop grande affaire. A cet engagement permanent et acharné pour plus grand que soit. A cette sorte d’affairement, ouvrant sur le grand large. Porteur et tout à la fois porté par l’air du temps au plus loin de la médiocrité des petites affaires du monde. Sans savoir où cela mènerait. Le fil, à un moment donné, s’est trouvé rompu. D’autres ont connu cela. Il serai facile de mentionner l’un de ces référents, Hölderlin, par exemple. Autre figure impressionnante. Hölderlin et la révolution française. Hölderlin inclassable (non romantique au milieu des romantiques), tout entier pris par ce choc et tout entier perdu par l’onde de choc en retour. Le merveilleux livre de Peter Härtling en donne un témoignage : “Plus nous nous trouvons aux prises avec le néant qui nous entoure (écrit Hölderlin) tel un gouffre béant, ou avec ce quelquechose à mille faces qu’est la société humaine et son activité, qui sans forme, sans âme et sans amour nous persécute et nous disperse, et plus la résistance doit être passionnée, violente et véhémente de notre part.....La détresse et l’indigence du dehors font de la plénitude de ton coeur indigence et détresse pour toi. Tu ne sais où porter ton amour et c’est ta richesse qui te réduit à la mendicité” (p. 342 de Holderlin). Texte prémonitoire. On sait à quel prix sa résistance l’a conduit.
Le rapprochement, si grandiloquent qu’il puisse paraître, porte témoignage d’un sérieux dont ces deux êtres (lui et Linhart) ne se sont pas départis par rapport à la hauteur de l'événement.
* Et 68?
Prendre la parole aujourd’hui ne signifie pas la même chose que
prendre la parole en ces années-là. Aujourd’hui, c’est le pathos qui
prime. L’épanchement de ses goûts et dégoûts. Ou son extrême
volontarisme : le “je veux”.
Qu’il en soit ainsi.
Il était temps, justement, que quelqu’un prenne la parole pour rappeler qu’entre le martyr et/ou la culpabilisation, d’un côté et l’autoritarisme de l’autre, il y a tout un champ de possible que ces années-là rendaient possibles.
Il était temps qu’au sein de ces célébrations, commémorations, ...un
livre étrange apparaisse. Un des rares à prendre une voie qui dise
autre chose que les sempiternels rodomontades des fiers à bras de
l’agitation et de l’idéologie ou des décimeurs de l’idée même d’utopie.
Un des rares qui laisse la parole aux anonymes, fils et filles
de....noms connus du militantisme.
Il ne s’agit pas d’une d’ une
attitude victimaire (= martyr) ou culpabilisatrice (= l’enfer, c’est
les autres). Pas de chair et de coeur à nu. Pas de nostalgie; pas de
bile répandue. Pas d’enthousiasme; pas d’exécration. Tout simplement
d’une re-prise, d’une ré-vision de ce qui n’a pas été vécu au clair
dans ces années-là. Être au net face à ce qui a été une tornade, une
accélération fabuleuse (à tous les sens qu’on voudra donner à ce
mot) pour les plus optimistes, voire une catastrophe pour les plus
pessimistes.
Il était temps que quelqu’un ouvre une page nouvelle et y inscrive, en bribes de vies éparses, à quel point “les années 68” sont irréductibles à tout autre événement politique. Car elles imposent les jeunes (lycéens, étudiants, jeunes ouvriers, jeunes chercheurs, jeunes artistes et créateurs...) comme moteurs d’avancées sociales, politiques et culturelles. Dorénavant, il faudra compter avec eux. Ce qui ne s’est pas démenti depuis. Et, combien ce qui importait alors, n’était pas le prestige, l’argent, mais le fait d’être vivant. Mieux encore : se sentir vivant. Qu’est-ce à dire, puisqu’il faut dire ce qui paraît d’évidence. Vivant ? C’est quand “on doit décider comment on vit, qu’est ce qu’on choisit comme vie, avec qui?” (René Lévy, p. 98).
Et il est heureux, qu’aujourd’hui, quelqu’un le re-dise en quelques superbes pages, après que d’autres l’aient alors proclamé, et expérimenté au risque de leur vie. Le bien le plus précieux ? se sentir vibrer, à plein temps, ose-t-on à peine dire, tant le vocabulaire d’aujourd’hui nous ramène inexorablement aux petits côtés des choses. Au travail partiel, éphémère. A la précarité. A la survie. Signe désastreux d’un temps sinistre de ce point de vue. Le nôtre.
* Mai 68.
Un événement hors du temps qui marque le temps d’avant et
le temps d’après. Une image pour l’imaginaire et le symbolique qui sert
de repoussoir ou d’envie.
Une violence qui ne voulait pas réinstaller une autre violence, mais en finir avec elle. Qui pensait ouvrir l’horizon.
Une
insurrection aux visages multiples qui dessaisissait jusqu’aux
avant-gardes révolutionnaires. Qui emportait tout sur son passage. Une
revendication qui demandait l’impossible et rendait tout possible.
Les
mots sont bien dérisoires à dire cela, qui se jouait là. C’est bien en
ce sens que les mots peuvent venir à manquer au moment du reflux. De
l’abandon. De la lassitude; des renoncements. Du besoin de stopper
cette folie. De marquer une pause à cette course effrénée. Les mots qui
ont manqué à Robert Linhart.
Un soulèvement sans morts, dit-on ? Un
soulèvement sans glissement vers le terrorisme? Du terrorisme, on a
conscience de cette suite-là. On l’a vu poindre ici, mais se déployer
ailleurs. Mais ce qu’on n’a pas vu, ce sont les dégâts “collatéraux”(page 120),
suivant une terminologie de maintenant. C’est compter sans les
suicides nombreux, les dépressions et surtout sans les effacements de toutes celles et tous
ceux qui se sont psychiatriquement égarés. Tout aussi importantes et
moins héroïques morts que sur des barricades.
Il faut penser alors qu’il est encore temps de marquer ces temps incroyables, puisque ces temps là
vont disparaître dans des mémoires aseptisées. Il faut se souvenir de
ces temps et de ces gens qui se sont engouffrés dans cette brêche sans
cibles et sans objectifs autres que d’être les plus en phase avec le
"kairos", l’imprévu, qui emplit et accompagne. Et non avec le nouveau,
qui s’efface en permanence et évide les coeurs en les remplissant et
les gavant à l’infini.
C’est à celles-là et ceux-là qu’il nous faut
penser. Celles et ceux dont l’investissement intellectuel, physique,
mental a montré un chemin sans retour possible, sans reniement
possible. Et qui ont tenté de continuer, malgré tout, au regard de ce
qui s’était alors entr’ouvert. Malgré l’inertie, le retour aux habitudes, aux
préjugés, aux hiérarchies. Et dont le destin a été de dire non et de
s’enfoncer dans la “résistance” avec la faillite de la “réussite
sociale” au bout.
A elles et eux qui n’ont rien acquis (pouvoir, statut, richesse).
A
toutes celles-là et à tous ceux-là dont les voix se sont tues, le
livre de Virginie Linhart donne quelque chose. Leur vie n’a pas été
“perdue”. Aux uns et aux autres, qui se sont exposés corps et biens et “âme” en
plus, il fallait l’apaisement. Ce livre est un livre de paix. Sans
exhortation. Sans affèterie langagière. Léger et important à la fois.
En fin de livre,
Virginie Linhart valide le “non” du père.
Elle rend positif l’échec qu’il a vécu. Redonne la parole perdue.
Cette parole lui revient par celles et ceux, enfants de 68 (dans la
critique aussi bien que dans l’acceptation, peu importe ici).
Car Virginie rejoue à sa manière ce que Robert, son père, a joué à la sienne.
Un
déplacement s’est opéré. Mais, au fond, en recherchant les enfants de
celles et ceux de 68, elle reconstitue cette “communauté” dans un
projet qu’elle mène à bien. Elle devient leader à son tour. Et,
redonnant vie à ce qui s’est passé pour elles et pour eux, par
contrecoup, elle redonne vie à ce qui s’est passé pour leurs parents.
Différence et répétition en quelque sorte. Différence et non des
moindres dans la répétition. Elle ne prétend pas, en effet, avoir raison. Ni dire ce qu’il
faut faire.
Ni bouleverser l’establishment.
Et de fait elle ne se situe pas dans un “pour ou un contre 68”, mais laisse les lecteurs juges. En ce sens, elle applique en le subvertissant ce principe communicationnel si familier : elle ne dit pas quoi penser mais à quoi penser.
Sources :
- Virginie Linhart : Le jour où mon père s'est tu, Paris, seuil, 2008, 174 p.
- Jean-Luc Nancy: Vérité et Démocratie, Paris, Galilée, 2008, 62 p.
- Peter Härtling : Hölderlin, biographie, Paris seuil, 1976, 473 p.
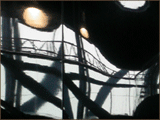
hello to you mate :)
i'm wondering...could you please include a google translation toolbar?? this could help us english speaking people better understand your blog :P
Cheers and thanks!
Rédigé par : Potenta | 10.04.2010 à 21:35